Physiologie appliquée aux APS. L1S2. S. Roffino PDF
Document Details
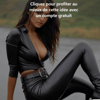
Uploaded by Roro
UPJV UFR STAPS
S. Roffino
Tags
Summary
Cours sur la physiologie appliquée aux activités physiques et sportives (APS). Le document décrit l'introduction à la physiologie de l'exercice, et introduit et détaille les concepts fondamentaux sur le système nerveux autonome.
Full Transcript
Physiologie appliquée aux APS. L1S2. S. Roffino Sommaire Sommaire I. INTRODUCTION A LA PHYSIOLOGIE DE L’EXERCICE................................................................... 1 A. L’EXERCICE INDUIT DES ADAPTATIONS DE L’ORGANISME......................................................
Physiologie appliquée aux APS. L1S2. S. Roffino Sommaire Sommaire I. INTRODUCTION A LA PHYSIOLOGIE DE L’EXERCICE................................................................... 1 A. L’EXERCICE INDUIT DES ADAPTATIONS DE L’ORGANISME............................................................................ 1 1.Des besoins énergétiques qui augmentent.............................................................................................. 1 2.Des substrats énergétiques qu’il faut mobiliser...................................................................................... 1 3.Des substrats qu’il faut dégrader.......................................................................................................... 1 4.Des adaptations qui découlent de l’augmentation des besoins énergétiques........................................... 1 5.Des adaptations ajustées et coordonnées aux besoins............................................................................ 1 B. NOTIONS SUR LE SYSTEME NERVEUX AUTONOME........................................................................................ 1 1. Le neurone, cellule fonctionnelle du système nerveux............................................................................ 1 2. Organisation générale du système nerveux............................................................................................ 2 3. Le système neurovétégatif..................................................................................................................... 3 a) SNV et homéostasie......................................................................................................................................... 3 b) Les structures du SNV...................................................................................................................................... 4 c) Un exemple de maintien de l’homéostasie, la régulation de la température (diapo 16)......................................... 5 d) Le SNV participe à ajuster les besoins au cours de l’exercice............................................................................. 6 I. Introduction à la physiologie de l’exercice A. L’exercice induit des adaptations de l’organisme 1. Des besoins énergétiques qui augmentent 2. Des substrats énergétiques qu’il faut mobiliser 3. Des substrats qu’il faut dégrader 4. Des adaptations qui découlent de l’augmentation des besoins énergétiques 5. Des adaptations ajustées et coordonnées aux besoins B. Notions sur le système nerveux autonome 1. Le neurone, cellule fonctionnelle du système nerveux Les organes qui constituent le système nerveux sont l’encéphale (c'est-à-dire les structures qui sont dans la boîte cranienne), la moelle épinière et les nerfs (Diapo 9). Ces organes sont principalement constitués de tissu nerveux dont le principal type de cellule est le neurone. 1 Physiologie appliquée aux APS. L1S2. S. Roffino Le neurone est une cellule qui a la propriété non seulement de générer un courant électrique mais également de le propager. Il est constitué d’une partie principale: le corps cellulaire. De ce corps cellulaire s’étendent 2 types de prolongements : - les dendrites, prolongements ramifiés - l’axone, un prolongement au diamètre le plus élevé, non ramifié pouvant être très long. Le rôle des prolongements (axone et dendrites) est de se connecter à d’autres neurones ou à d’autres structures (ex : muscle, glande endocrine). En effet, un neurone a vocation de communiquer avec une autre cellule. La zone au niveau de laquelle la communication intercellulaire a lieu se nomme la synapse (la JNM dans le cas de la cellule musculaire). Au niveau de la synapse, le courant électrique généré par le neurone présynaptique se propage jusqu’à son extrémité. Ce courant induit la libération de molécules qu’on appelle des neurotransmetteurs (ou neuromédiateurs). Ces derniers vont se fixer sur la cellule post-synaptique (un autre neurone ou la fibre musculaire) par l’intermédiaire de récepteurs spécifiques et cela va déclencher sur cette cellule une réponse. Dans le cas où la cellule post-synaptique est un neurone ou une fibre musculaire la réponse est la naissance d’un nouveau courant électrique. La communication dans ces deux cas est donc une succession de 3 évènements, un évènement électrique, un évènement chimique et de nouveau un évènement électrique. 2. Organisation générale du système nerveux Le système nerveux est organisé en un Système nerveux central et un système nerveux périphérique (diapo 10). Le système nerveux central Le système nerveux central est constitué de l’encéphale et de la moelle épinière. Ces structures ont pour fonction d’intégrer les informations qui leur parviennent en provenance de la périphérie de l’organisme. Le SNC analyse ces infos et décide d’actions à mener si nécessaire. Il est alors ordonnateur d’informations vers la périphérie. Le système nerveux périphérique Le système nerveux périphérique est constitué de nerfs. Il existe deux types de nerf : les nerfs afférents et les nerfs efférents. Les nerfs afférents véhiculent les informations de la périphérie vers le SNC (voies afférentes), ils sont très souvent (mais pas toujours) associés à des récepteurs 2 Physiologie appliquée aux APS. L1S2. S. Roffino dont le rôle est de capter les variations de paramètres internes (Ex : pression artérielle) ou externes (Ex : Température extérieure). Les nerfs efférents véhiculent des informations du SNC vers la périphérie (voies efférentes). D’un point de vue anatomique, les nerfs sont constitués de faisceaux d’axones. 3. Le système neurovétégatif a) SNV et homéostasie Parmi les structures du SNC et du SNP, certaines sont dédiées au maintien de l’homéostasie. L’ensemble de ces structures forment le système nerveux neurovégétatif ou système nerveux autonome (Diapo 11) L’homéostasie, c’est quoi ? Dans un organisme au repos (diapo 12), les cellules de nos différents tissus et organes travaillent pour assurer le fonctionnement de l’organisme. Cette production énergétique minimale est appelée le métabolisme basal. Pour assurer ce fonctionnement minimum, les cellules doivent produire de l’énergie sous forme d’ATP. Pour cela, les cellules prélèvent, du milieu dans lequel elles baignent, les nutriments et l'oxygène nécessaires à leurs différentes activités cellulaires. D'un autre côté, la cellule rejette les produits de son activité. L’environnement dans lequel baignent les cellules doit être renouvelé en permanence. En effet, une pénurie de nutriments ou d'oxygène de même qu’une accumulation de déchets dans le milieu environnant seraient fatales à la cellule. C’est grâce aux échanges permanents entre le sang et l’environnement de la cellule que ce dernier est d’une part épuré de ses déchets, et d’autre part approvisionné en oxygène et nutriments. D'un autre côté, le sang est en relation avec le milieu extérieur par l'intermédiaire d'organes spécialisés comme les poumons, l'appareil digestif et les reins. Ces derniers permettent respectivement les échanges gazeux (entrée d'oxygène et sortie de dioxyde de carbone), l'absorption des nutriments, et l'épuration du plasma et l'élimination des déchets. Les différents niveaux d’échange environnement/sang et sang/milieu extérieur permettent de maintenir une stabilité de l’environnement de la cellule qui garantit sa survie. Ainsi, l’homéostasie est la capacité à maintenir l’environnement cellulaire et le sang les plus stables possibles afin de garantir la survie cellulaire par des ajustements permanents. 3 Physiologie appliquée aux APS. L1S2. S. Roffino Au repos, les différents systèmes physiologiques sont donc amenés à travailler ensemble pour le maintien de l’homéostasie (Diapo 13). Ce maintien de l’homéostasie est rendu possible par le maintien de paramètres physico-chimiques du sang (paramètres homéostasiques) qu’il est nécessaire d’ajuster et de réguler en permanence. Le système nerveux sympathique contrôle pour une part ces ajustements. b) Les structures du SNV Comment le système neurovégétatif est-il organisé? Le système neurovégétatif est composé de voies nerveuses afférentes qui peuvent être associées à des récepteurs qui sont capables de détecter : - des variations de paramètres interne comme la pression artérielle - des variations externes comme par exemple la température de l’environnement. Ces nerfs font remonter les informations vers les centres nerveux. Les centres nerveux du SNV sont situés dans la moelle épinière, le bulbe rachidien et l’hypothalamus. Le bulbe rachidien renferme les centres cardiaques, vasculaires et respiratoires. Ce sont les centres qui commandent l’activité du cœur, des vaisseaux et la respiration. L’hypothalamus est une structure clé du SNV car a un rôle dans la réaction végétative au stress. Enfin, des voies afférentes permettent de relayer les ordres prises par les centres végétatifs vers la périphérie. 2 types de nerfs efférents sont identifiés dans le SNV: les nerfs sympatiques et les nerfs parasympathiques. Le système nerveux végétatif régule les fonctions organiques internes (dont système cardiovasculaire, système respiratoire, système digestif et fonction rénale) et les adapte aux besoins du moment. Ces activités échappent au contrôle volontaire (d’où autonome). La Diapo 15 est une illustration des voies nerveuses efférentes sympathiques et parasympathiques qu’on appelle aussi Système nerveux (Ortho)Sympatique et Système nerveux Parasympathique. Généralement, les organes reçoivent une innervation sympatique et une innervation parasympatique. Ces voies nerveuses sont sous l’influence des centres végétatifs supérieurs. Généralement les nerfs sympatiques et parasympatiques qui innervent un même organe ont des effets opposés. Par exemple, au niveau du cœur, le nerf parasympathique a pour effet de réduire la fréquence cardiaque alors que le nerf sympathique l’accélère. 4 Physiologie appliquée aux APS. L1S2. S. Roffino Comment les nerfs sympatiques et parasympatiques exercent leurs effets sur les organes? Prenons l’exemple du cœur. Quand la commande centrale végétative décide de réduire l’activité cardiaque, une info électrique part des centres et est relayée par le Système nerveux Parasympathique. Au bout du nerf, les axones vont libérer un neuromédiateur, l’acétylcholine. Cette dernière se fixe sur un récepteur spécifique sur les cellules cardiaques et induit une réponse qui est la baisse de la fréquence cardiaque. A l’inverse, quand la commande centrale végétative décide d’augmenter l’activité cardiaque, une info électrique part des centres et est relayée par le par le Système nerveux sympathique. Au bout du nerf, les axones vont libérer un neuromédiateur, la noradrénaline. Cette dernière se fixe sur un récepteur spécifique sur les cellules cardiaques et induit une réponse qui est l’augmentation de la fréquence cardiaque. c) Un exemple de maintien de l’homéostasie, la régulation de la température (diapo 16) La régulation de la température corporelle est un exemple de régulation qui implique le SNV. Si on place un sujet dans un environnement où la température est de 35°, le corps va se réchauffer. La T° centrale de notre corps (la température de notre milieu intérieur) constitue un paramètre homéostasique. Il s’agit donc d’un paramètre contrôlé et régulé par des ajustements permanents du corps. Le centre végétatif impliqué dans cette régulation est l’hypothalamus. Celui-ci reçoit des informations en provenance de la périphérie par le biais de capteurs au chaud ou au froid localisés dans la peau et qui donne une information de la température de l’environnement. Ces informations sont relayées par les voies nerveuses afférentes. L’hypothalamus analyse l’information qui lui parvient. Dans le cas où il fait chaud, l’hypothalamus va ordonner des actions visant à perdre de la chaleur. Des ordres (sous la forme de courants électriques) vont partir de l’hypothalamus et vont être relayées par le système nerveux sympathique en direction des vaisseaux sanguins de la peau. Le diamètre de ces vaisseaux va augmenter dans le but de favoriser la déperdition de chaleur. C’est la raison pour laquelle on devient tout rouge quand on a chaud. En augmentant la déperdition de chaleur, on permet la diminution de la température du corps. La régulation de la température corporelle n’est pas aussi simple et elle implique d’autres récepteurs ainsi que d’autres effecteurs! 5 Physiologie appliquée aux APS. L1S2. S. Roffino d) Le SNV ajuste les adaptations en fonction des besoins au cours de l’exercice Le SNV ajuste les adaptations en fonction des besoins au cours de l’exercice (diapo 17). L’état d’équilibre que recherche l’organisme en permanence (état d’homéostasie) est un état qui est perturbé par l’exercice physique. Toutes les formes de stress perturbent l’homéostasie. Le stress psychologique perturbe l’homéostasie. Les stress physiologiques comme par exemple l’état de jeûne perturbe l’homéostasie. L’exposition prolongée dans un environnement chaud ou froid perturbe l’homéostasie. Si l’on se place au niveau cellulaire, toutes les cellules dont l’activité est accrue au cours de l’exercice vont prélever dans l’environnement qui les entoure de quoi produire l’énergie nécessaire à leur nouveau niveau d’activité. Cela va donc appauvrir le milieu dans lequel elle baigne en 02 et en nutriments. Par ailleurs, l’augmentation de leur activité va conduire à augmenter la production de sous-produits du métabolisme. Enfin, la production d’énergie conduisant à une production de chaleur, la température corporelle centrale va s’élever dans la cellule et dans son environnement. Comme il y a des échanges entre le sang et l’environnement de la cellule c’est tout le milieu intérieur (environnement cellulaire + sang) qui est déstabilisé par l’exercice. La stabilité de l’environnement de la cellule et son renouvellement étant une condition de sa survie, l’organisme va s’adapter à cette situation nouvelle en recherchant un nouvel état d’équilibre en procédant à des ajustements (diapo 18). On va (diapo 18) : - débloquer des réserves de substrats pour alimenter la cellule, - on va augmenter l’apport d’O2 en augmentant l’activité du système respiratoire ce qui va permettre parallèlement d’éliminer le surplus de CO2, - on va augmenter l’activité du SCV pour acheminer l’O2 et les nutriments vers les tissus actifs. En même temps, il va participer à contrôler les variations de température liées à la production de chaleur, - le rein va être chargé de l’élimination des déchets métaboliques mais il va aussi être impliqué dans le contrôle de la déshydratation. Et tout cela va se faire de manière coordonnée. 6 Physiologie appliquée aux APS. L1S2. S. Roffino Voici un exemple de coordination entre le métabolisme et l’activité cardiaque (Diapo 19). Au cours d’un exercice, l’activité cardiaque s’élève. Quelles sont les raisons pour lesquelles la fréquence cardiaque s’élève au cours de l’exercice? Le cœur est un organe innervé par des nerfs sympathiques et des nerfs parasympathiques. Il est sous le contrôle des voies efférentes végétatives qui sont contrôlées par le centre cardiaque qui se trouve dans le bulbe rachidien. Au cours de l’exercice, des informations remontent vers le bulbe rachidien par des voies nerveuses afférentes en provenance des muscles. Ces nerfs réagissent à l’activité mécanique et métabolique des muscles actifs. Lorsque l’activité mécanique et l’activité métabolique s’élèvent, ces nerfs font remonter l’information vers le bulbe rachidien qui va ajuster la fréquence cardiaque par le biais du système nerveux sympathique et parasympathique. Il existe donc une coordination entre l’activité musculaire et l’activité cardiaque. En conclusion de ce chapitre (Diapo 20), nous avons montré : - que l’exercice nécessitait des adaptations d’ordre métabolique, cardiovasculaire et respiratoire, - que les adaptations étaient coordonnées et ajustées aux besoins - que le système neurovégétatif était impliqué dans ces ajustements. Toutefois, un autre système participe au maintien de l’homéostasie et à l’ajustement des adaptations aux besoins, c’est le système endocrinien. 7